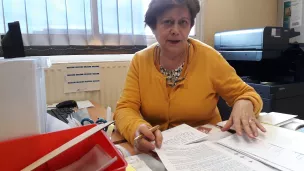Mémoire : faut-il passer les mauvais souvenirs aux oubliettes ?
Au fil des ans, les scientifiques découvrent le cerveau et nous apprennent à mieux comprendre les mystères de la mémoire. Mais au quotidien, des situations viennent des déclencher parfois de douloureux souvenirs. Alors faut-il passer les mauvais souvenirs aux oubliettes ? Surmonter les traumatismes et décrypter le cerveau humain, une émission Je pense donc j'agis présentée par Madeleine Vatel et Melchior Gormand.
 Illustration du cerveau ©Freepik
Illustration du cerveau ©FreepikCe qu'il faut retenir :
- Certaines situations sont si éprouvantes qu'on en garde un souvenir extrêmement précis
- Partager un souvenir douloureux avec d'autres, ou avec son médecin est le début vers la résilience
- La parole peut passer par trois questions : Que s’est-il passé ? Qu’est-ce que j’ai ressenti ? Qu’est-ce qui a été le plus difficile ?
- Dans la Bible, de nombreux récits évoquent la question du souvenir à travers des récits et des personnages
L’histoire d’une vie est constamment nourrie par son lot de drames et d’événements joyeux. D’un souvenir insignifiant à un événement décisif, notre cerveau s’efforce de rendre ce récit cohérent. Lorsque l’on dort, il est en activité. Dans notre hippocampe (partie du cerveau), un grand tri de la mémoire a lieu. Un travail qui, plus tard, nous aide à nous souvenir des détails, des émotions, des odeurs, et parfois des traumatismes.
Comprendre le souvenir
Alors que représente un souvenir ? Francis Eustache, neuropsychologue de formation, définit le souvenir comme “une rencontre psychique”. Cette rencontre se décline en plusieurs combinaisons d’informations qui sont différentes d’un individu à un autre. Dans un souvenir, certains individus se rappelleront davantage du son, de l’odeur ou bien de ce qu’ils ont vu.
Les combinaisons sont vastes. Pour Francis Eustache, également directeur d'étude à l'EPHE de Paris, les souvenirs sont là dans un but précis : “créer le récit autobiographique”. L’idée est de tisser des liens entre les événements. “On va recycler, conserver les informations importantes et les lier entre elles pour créer un récit". Le psychologue Patrick Estrade ajoute que “c’est un flux constant”. Ce travail intellectuel agit en arrière-plan de notre cerveau sans qu’on n'y prête attention. Le cerveau fait le tri entre les bons et les mauvais souvenirs. Quelle est la différence ?
Les souvenirs permettent de créer un récit autobiographique.
La frontière est floue entre un bon et un mauvais souvenir. Ces concepts se placent dans un spectre moral propre à chacun. Dans notre cerveau, il y a des souvenirs utiles et d’autres moins. Cette sélection se fait en fonction de la construction de notre ”récit autobiographique”. Cependant, un type de souvenir est facilement identifiable : les traumatismes.
Faut-il tout oublier ?
Un traumatisme est un événement très singulier, marquant la vie de ceux qui en vivent. Patrick Estrade, psychologue et écrivain, le décrit comme “une onde de choc qui s’engramme dans le cerveau”. Francis Eustache parle de "blessure psychique”. Parfois, “cela conduit à une rupture avec les proches”, précise le neuropsychologue. Un traumatisme peut déclencher plein de choses contraires au fonctionnement normal du cerveau.
Je vis mon traumatisme. Je vis avec en permanence.
Francis Eustache explique que "le cerveau de la personne évitera les sons, les odeurs et les éléments disparates liés au traumatisme”. Pour faire plus simple, Jennie Girard, accompagnatrice de personnes traumatisées, parle “d’une blessure du cœur qui nous coupe avec nous-mêmes et qui laisse des cicatrices”. Marie, une auditrice, reste marquée par ces souvenirs : “tous les jours, je vis mon traumatisme. Je vis avec en permanence”.
En prenant l’exemple des témoignages des victimes de Klaus Barbie pendant son jugement, Francis Eustache souligne le côté exceptionnel de ces récits. ”L’exemple est une exception, c’est tellement fort que les souvenirs sont étonnamment précis. De manière générale, les souvenirs se modifient dans le temps. Le cerveau est très plastique", soutient le scientifique. Le traumatisme est si profond qu’il peut transformer entièrement les individus en fonction de leur relation avec ces "blessures psychiques". Face à ces défis personnels, plusieurs possibilités existent pour les surmonter.
L’oubli, le fusible de la mémoire
“Deux personnes qui vivent un événement ne le vivent pas pareilles”, explique Francis Eustache. La vie et ces événements font que “le cerveau ne fait remonter que les souvenirs qu’on peut supporter”. Cette différence entre les individus dans leur gestion des souvenirs s’incarne comme des barrières. “Le refoulement des souvenirs, c’est salvateur, ça nous aide à être résilients face aux traumatismes”. Pour illustrer ses propos, Francis Eustache parle de “l'image de l'ascenseur de l'inconscience”. Pour lui, le souvenir monte et descend en fonction de notre capacité à le supporter.
La tyrannie des souvenirs.
Parfois, les souvenirs prennent des années à remonter. Patrick Estrade parle même de “la tyrannie des souvenirs”. Il arrive que les individus prennent “50 à 60 ans avant que leurs souvenirs ne s'expriment librement”, développe le psychologue, auteur de "ces souvenirs qui gouvernent" publié aux éditions Laffont. Prenant l'exemple des survivants de la Shoah, il souligne que le souvenir ,“c’est important pour les familles et pour la société”. Quand le traumatisme remonte, il vient bousculer, voire détruire le récit que l’on se fait de soi-même. Francis Eustache appelle ça le “raisonnement autobiographique”, un temps qui est parfois en désaccord avec le temps vécu par les membres de son entourage.
Accepter le souvenir et le surmonter
Jennie Girard accompagne des personnes traumatisées au sein de parcours de plusieurs séances avec des petits groupes, avec l'association "APTE". Pour elle, reconnaître un traumatisme peut se réfléchir en trois questions :
- Que s’est-il passé ? Elle invite à reproduire chronologiquement en faisant appel aux faits. “Ça permet de reprendre le contrôle et du recul."
- Qu’est-ce que j’ai ressenti ? Les traumatismes sont liés aux émotions. “Les comprendre et l'accepter permettent de comprendre le traumatisme."
- Qu’est-ce qui a été le plus difficile ? “Ça permet de laisser la liberté aux personnes de dire ce qui a été dur, sans faire de suppositions blessantes.”
Lorsque l’on demande à quelqu'un de raconter un souvenir, la personne doit convoquer le traumatisme. Le procédé peut être pénible, et pour cela, il faut transformer le traumatisme en quelque chose d’autre.
Il faut se faire accompagner.
Le psychologue Patrick Estrade soutient que “le traumatisme est de l’ordre de la délivrance. Il faut sublimer ce qui fait souffrir” pour mieux le vivre. Les trois experts sont unanimes : “il faut se faire accompagner !”. Pour ça, il y a des groupes de paroles comme ceux de Jennie Girard. “Ce sont des groupes de 12 personnes où la parole se libère. Un des modules s’appelle 'Si Dieu nous aime, pourquoi souffrons-nous ?' Quand on est aidé et accompagné et qu’on se rencontre, c’est constructeur, c’est de la résilience”, explique l’accompagnatrice. “Les églises et les associations, c’est un bon début dans la guérison”, raconte-t-elle. Francis Eustache rappelle qu'en France, les psychologues sont très compétents notamment sur les événements traumatisants. Ils sont bénéfiques et ils évitent le stress post-traumatique grâce à de nombreuses méthodes et approches, comme l'EMDR.


Cette émission interactive de deux heures présentée par Melchior Gormand est une invitation à la réflexion et à l’action. Une heure pour réfléchir et prendre du recul sur l’actualité avec des invités interviewés par Véronique Alzieu, Pauline de Torsiac, Stéphanie Gallet, Madeleine Vatel et Vincent Belotti. Une heure pour agir, avec les témoignages d’acteurs de terrain pour se mettre en mouvement et s’engager dans la construction du monde de demain.
Intervenez en direct au 04 72 38 20 23, dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis ou écrivez à direct@rcf.fr
Pour aller plus loin
Suivez l’actualité nationale et régionale chaque jour
 Je pense donc j'agis55 min
Je pense donc j'agis55 minEn partenariat avec SPQR Conseil
RCF vit grâce à vos dons
RCF est une radio associative et professionnelle.
Pour préserver la qualité de ses programmes et son indépendance, RCF compte sur la mobilisation de tous ses auditeurs. Vous aussi participez à son financement !