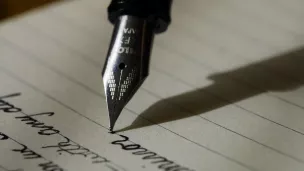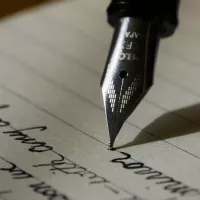Le sens chrétien de l'amour expliqué par Kierkegaard
Aimer l'autre et se découvrir soi. Au XIXe siècle, le philosophe Kierkegaard a émis une pensée d'avant-garde sur l'amour comme cheminement vers soi-même. Une pensée profondément actuelle qui nous aide à comprendre le sens chrétien de l’amour.
 Si "Dieu est amour", alors cela signifie "qu'il y a une présence de Dieu dans toutes les formes d’amour quelles qu’elles soient". ©Hans Lucas
Si "Dieu est amour", alors cela signifie "qu'il y a une présence de Dieu dans toutes les formes d’amour quelles qu’elles soient". ©Hans LucasC'est un aspect peu connu de l’œuvre de Søren Kierkegaard : l’amour pour devenir soi-même. Le philosophe danois, penseur de l’existentialisme chrétien, a proposé au XIXe siècle une vision originale et moderne de l'amour. "L’amour a subi des mutations de compréhension et de pratiques considérables depuis le XIXe siècle et pourtant, Kierkegaard nous dit des choses extrêmement contemporaines, extrêmement fines et incisives pour aujourd’hui." C'est ce que constate Frédéric Rognon, professeur de philosophie des religions à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Il est l'auteur de "Vivre et penser l’amour avec Kierkegaard" (éd. Labor et Fides, 2024). Un ouvrage dense mais accessible qui montre combien la pensée de Kierkegaard aide à vivre de la manière la plus ajustée notre condition humaine sans renoncer à l’absolu.
"Dieu est amour" : la portée du philosophique du verset de Jean selon Kierkegaard
Kierkegaard a l’image d’un homme plutôt "austère, sombre et mélancolique". Il parle pourtant d’amour avec "joie et bonheur", observe Frédéric Rognon. C’est même "un thème présent tout au long de son œuvre, il n’y a pas une page de son œuvre totale qui n’aborde cette question. Or, elle avait été relativement peu analysée. Et parfois, quand elle avait été analysée, à mon sens elle l’était de manière quelque peu partisane."
Un de ses ouvrages en particulier est entièrement consacré à la question de l’amour : "Les œuvres de l’amour", paru au Danemark en 1847. Kierkegaard y propose dix-huit méditations à partir de versets de passages bibliques. Il commente par exemple le verset : "Dieu est amour." (Jn 4, 8) "Ce n’est pas que Dieu est aimant, miséricordieux, ni même que Dieu aime, c’est qu’il est amour, commente Frédéric Rognon. Ça signifie donc que chaque fois qu’il y a de l’amour, Dieu est présent. Il y a une présence de Dieu dans toutes les formes d’amour quelles qu’elles soient."
Par conséquent, "si j’aime une personne, alors nous sommes trois, nous dit Frédéric Rognon. Moi, la personne aimée et Dieu qui est la relation entre moi et elle. Ça nous ouvre des perspectives considérables puisqu’au quotidien nous allons rencontrer Dieu dans les relations que nous avons avec les autres."
Se découvrir soi-même : Kierkegaard précurseur du développement personnel ?
Dieu est amour, donc, nous disent les Écritures. Elles disent aussi que Dieu a créé l’être humain à son image. "Ça signifie que lorsque j’aime, je me rends toujours plus image de Dieu. Ce qui m’amène à être de plus en plus moi-même dans la mesure où Dieu m’appelle à être un être aimant." Et non seulement l’amour nous conduit à nous découvrir nous-mêmes mais il permet aussi à l’être aimé de devenir lui-même. "L’amour a ce double effet", commente Frédéric Rognon. En cela, aimer est "un chemin passionnant" pour Kierkegaard, même si c'est "un chemin semé d’embûches". Ses fiançailles rompues avec Regine Olsen ont marqué profondément sa vie.
Se découvrir soi, apprendre à être soi-même... La pensée de Kierkegaard est en affinité très forte avec la culture contemporaine. Elle "annonce les évolutions de la fin du XXe siècle et du XXIe siècle avec une focalisation sur la découverte de soi-même, une coïncidence avec le moi-profond". Des expressions qui semblent très actuelles, admet Frédéric Rognon : elles ont pourtant été énoncées "à une époque où ce n’était pas du tout à l’ordre du jour".
Cependant Kierkegaard est en rupture avec le développement personnel tel qu'on le comprend aujourd'hui. Notre société est marquée par un épanouissement individualiste qui prône un idéal très ambivalent d’authenticité mais qui peut être aussi une forme illusoire d’autosuffisance. L’amour selon Kierkegaard "nous amène à nous décentrer de nous-mêmes, à nous dé-préoccuper de nous-mêmes pour nous en remettre à Dieu, qui nous permettra de devenir nous-mêmes". Chez le philosophe danois, on ne devient pas soi-même par ses propres forces. Cela "requiert le passage par l’altérité divine, par le sceau de la foi entre les mains de Dieu".
Quand l'amour chrétien "purifie" l'amour
En français - comme en danois d’ailleurs – on utilise le même mot pour aimer "la bière, mon pays, ma femme, mes enfants, mes amis, mon prochain ou mon Dieu". La langue grecque nous permet de distinguer quatre types d’amour. Il y a l’eros ou "amour psychique", qui comprend l'amour charnel et sentimental. La filia, le fait d’aimer ses amis, qui procède d’un choix. Ou encore la piété filiale, c'est-à-dire les liens qui se développent par exemple entre parents et enfants, où nous ne choisissons pas l’objet de l’amour.
Il y a enfin l’agapè, qui correspond à l’amour chrétien. C’est cet amour du prochain dont il est si souvent question dans l’Évangile. Il est question d’aimer quelqu’un non pas parce que je l’ai choisi ni même parce que j’ai des liens de parenté avec lui. C’est aimer le prochain "quel qu’il soit, même si je n’ai aucun lien ni attraction avec lui". Frédéric Rognon souligne que "cette forme d’amour est un amour inconditionnel" qui ne comporte pas même de "condition de réciprocité". Il ajoute par ailleurs que "c’est un commandement pour le chrétien".
Entre ces quatre formes d’amour, y en a-t-il une plus importante que les autres ? Est-il donné de vivre l’une à l’exclusion de l’autre ? Pour Kierkegaard il n’y a "ni exclusion mutuelle en ces quatre formes d’amour, ni hiérarchisation, ni compartimentage mais une relation dialectique". Il s’agit de "tenir ensemble chacune de ces formes d’amour, en lien avec l’agapè". Par exemple, je peux conjuguer eros et agapè et considérer que mon conjoint est aussi mon prochain. Pour Kierkegaard, l’agapè a pour effet de "purifier" les autres formes d’amour, toujours plus ou moins empreintes d’égoïsme. On peut en effet laisser s’infiltrer dans les relations d’amitié une peur de la solitude.
En parallèle de cette fonction cathartique, on ne peut passer à côté d’une dimension agonistique. C’est-à-dire de l’ordre du combat. "Aimer son conjoint d’eros et d’agapè en même temps ne va pas de soi. Cela demande un combat contre soi-même, un combat intérieur, spirituel, explique Frédéric Rognon. Tout au long de sa vie, le chrétien va assumer ce combat à l’intérieur de lui pour arriver à articuler les formes humaines d’amour avec l’agapè." Pour Kierkegaard l’agapè, l’amour chrétien, permet d’unifier la personne. "Une unification dans la tension."


Mieux comprendre le monde, dans lequel nous sommes invités à vivre en chrétiens, grâce aux travaux des historiens, des sociologues et des artistes ainsi qu’à travers la réflexion philosophique. C'est ce que vous proposent Monserrata Vidal et Sarah Brunel.
Pour aller plus loin
Suivez l’actualité nationale et régionale chaque jour
 Visages59 min
Visages59 min
RCF vit grâce à vos dons
RCF est une radio associative et professionnelle.
Pour préserver la qualité de ses programmes et son indépendance, RCF compte sur la mobilisation de tous ses auditeurs. Vous aussi participez à son financement !