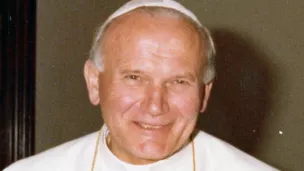Ils ont été "protégés" par les papes pendant cinq siècles : qui sont les Juifs du pape ?
Ils ont assuré une présence juive en Provence malgré les expulsions et les conversions forcées. Les Juifs du pape ont bénéficié pendant cinq siècles de la "protection" des papes. Vivant dans des carrières - c'est-à-dire des ghettos - en Avignon mais aussi à Carpentras, Cavaillon et L'Isle-sur-la-Sorgue, ils ont développé une culture et des rites qui leur sont propres. Qui sont les Juifs du pape aujourd’hui ?
 La synagogue d'Avignon ©wikimedia commons
La synagogue d'Avignon ©wikimedia commonsEn cette période d’augmentation des actes antisémites en France, il n'est pas inutile de rappeler la présence multiséculaire des Juifs dans notre pays. Autour d’Avignon, elle remonte à l’époque romaine. L’histoire du judaïsme provençal est une histoire dense, riche et souvent méconnue. En particulier celle des Juifs du pape : qui sont-ils aujourd’hui, quelle est leur histoire ?
Les Juifs du pape, cinq siècles d'histoire
Pendant cinq siècles des communautés juives ont bénéficié en Provence de la protection des papes. Une protection relative qui illustre le modèle de l’alliance verticale définit par l’historien Yosef Yerushalmi. Ou comment, au cours des siècles, des communautés juives persécutées ont trouvé auprès de seigneurs locaux une protection en échange de contreparties.
En Avignon, à Carpentras, Cavaillon et l'Isle-sur-la-Sorgue, les communautés juives vivaient dans des carrières, l’équivalent de ghettos. Entre elles et les papes, "c’est une relation qui est verticale ou asymétrique, décrit Justine Van Minden, vice-présidente et porte-parole de l'ACJP, Association culturelle des Juifs du pape, puisque les Juifs ont bénéficié de cette autorisation de rester sur place en échange de contreparties... Ils étaient en partie discriminés, ghettoïsés, utilisés parfois humiliés mais pouvaient continuer à être sur place et à pratiquer leur religion malgré tout."
Pourquoi les papes ont-ils protégé les Juifs ?
Les Juifs ont été expulsés du Languedoc au XIVe siècle, ceux de Provence au XVIe siècle. Alors que "les rois capétiens et les Valois expulsaient les Juifs dans tout le royaume de France, les tuaient ou les forçaient à la conversion", les papes ont accepté les communautés juives dans leurs territoires.
La période du Moyen Âge est une période de confrontation entre les papes et les rois. Accueillir les Juifs sur les territoires pontificaux a été pour les papes un moyen de renforcer "leur légitimité sur les populations chrétiennes à cette époque". "Maintenir les populations, les communautés juives dans cet état de dépendance, de punition, de soumission, servait de témoignage", explique Justine Van Minden. Voire de contre-témoignage puisqu’il s’agissait de "prouver aux communautés chrétiennes que les juifs étaient dans cette condition parce qu’ils n’avaient pas reconnue en Jésus le Messie".
Si les papes ont protégé les Juifs pendant cinq siècles, c’est aussi pour des raisons socio-économiques, précise Justine Van Minden. "C’était bien utile d’avoir des communautés qui pouvaient exercer certains métiers comme le prêt d’argent." La citoyenneté ayant été accordée aux Juifs à la Révolution française, en 1791, les communautés juives se sont ensuite disséminées.
Qui sont les Juifs du pape aujourd’hui ?
Entre 250 à 300 personnes seraient aujourd’hui conscientes de faire partie de la communauté des Juifs du pape. "Ce que je me dis, c’est qu’il y a qu’il y a plein de descendants des Juifs du pape qui ne savent pas forcément qu’ils sont issus de cette histoire, confie Justine Van Minden, elle-même descendante du grand rabbin d’Avignon Benjamin Mossé. Et c’est aussi notre travail dans l’Association culturelle des Juifs du pape de sensibiliser de faire connaître cette histoire pour que les jeunes puissent se raccrocher à ces racines, à cette identité qui est très riche." L’AJCP compte une cinquantaine de membres.
Une communauté qui tient aujourd'hui garder le nom de "Juifs du pape". C’est "une forme de reconnaissance de cette protection des papes sur ces communautés à une époque où c’était soit ça, soit être expulsé, mourir, nous dit la porte-parole de l’ACJP. Et finalement, ça aurait abouti à la disparition d’une identité, d’une culture qui est encore aujourd’hui présente, vivante et c’est une forme de reconnaissance de l’histoire et de cette alliance verticale."
Ni sépharades ni ashkénazes, les Juifs du pape ont leurs propres rites, leurs traditions culinaires et leur langue. Le dabérage, qui vient de l’hébreu "dabar" ("parler"), est un mélange d’hébreu moderne et biblique, de provençal et de français. Le linguiste Peter Nahon, auteur du livre "Les parlers français des israélites du Midi" (éd. Linguistique et de Philologie, 2023), la décrit aujourd’hui comme une langue à la laquelle « on a recours… dans toutes les situations où il peut être utile de ne pas se faire comprendre d’autrui, mais aussi, entre soi, "pour s’amuser", pour se constituer, entre locuteurs, une sorte de connivence linguistique plaisante ». Pour Justine Van Minden, elle lui a été transmise "presque comme une langue maternelle".
La synagogue de Carpentras est la plus ancienne synagogue de France encore en activité. Elle est emblématique de tout ce patrimoine matériel et immatériel des Juifs du pape. Ce joyau de l’art baroque témoigne de la façon dont ces communautés qui ont vécu en ghettos ont tout de même eu des échanges avec les communautés chrétiennes de Provence. "Aujourd’hui, être juif du pape, c’est être juif, provençal, français, républicain", rappelle Justine Van Minden. "Nous sommes l’exemple même que les cultures ne s’excluent pas, mais s’additionnent."


Comment comprendre les rites, les fêtes qui rythment le calendrier hébraïque ? Comment lire la Bible à la lumière de la tradition juive ? Qu’apporte la lecture du Talmud ou les textes de Maïmonide à un croyant juif... ? Chaque semaine, dans un dialogue avec un fin connaisseur du monde juif, Odile Riffaud nous fait entrer dans la richesse de cette tradition religieuse qui est à la racine du christianisme et de l’islam.
Pour aller plus loin
Suivez l’actualité nationale et régionale chaque jour
 Nos frères aînés12 min
Nos frères aînés12 min
RCF vit grâce à vos dons
RCF est une radio associative et professionnelle.
Pour préserver la qualité de ses programmes et son indépendance, RCF compte sur la mobilisation de tous ses auditeurs. Vous aussi participez à son financement !